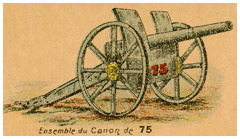
3. Les armes
3.3. L'artillerie
L'artillerie est l'arme par excellence en 1914-1918, celle qui causa 75% des blessures de guerre et entraîna les traumatismes psychologiques les plus forts. Deux conceptions s'opposent néanmoins. Pour les Français il s'agit d'obtenir l'avantage par des attaques violentes soutenues par des canons légers et mobiles à tir direct (le fameux "75"). Les Allemands privilégient au contraire les gros calibres, dominateurs sur le champ de bataille mais à mobilité réduite. Au final, l'artillerie française est adaptée pour une guerre courte et brutale où le couple canon - fantassin doit renverser l'adversaire. Elle devient inopérante face aux tirs indirects et lointains des pièces allemandes capables de briser les attaques. En revanche, il existe pour les Allemands un décalage entre l'avancée de l'infanterie et les mouvements plus lents des artilleurs qui ne peuvent servir de soutien.
L'utilisation de l'artillerie évolue avec la guerre : en 1914 les canons accompagnent l'infanterie et, dans le cas allemand, réduisent les ouvrages défensifs (le fort de Manonviller par exemple). À partir de 1915, préparations d'artillerie et combats au sol s'épaulent graduellement pour arriver en 1917 aux barrages roulants synchronisés aux assauts. Cette optimisation est rendue possible par les progrès des liaisons entre les batteries et l'avant, l'utilisation de la reconnaissance aérienne et l'efficacité de la logistique.
Parallèlement à la multiplication des pièces, la panoplie des canons s'élargit durant tout le conflit, quelles que soient les armées. Aux lance-grenades et mortiers de tranchées à tirs verticaux, dits «crapouillots» côté français et «minenwerfer» côté allemand, répondent à l'opposé les pièces montées sur rail de l'artillerie lourde (le 520 mm français ou le Pariserkanone de 210 mm, faussement appelé "Grosse Bertha" et tirant à près de 120 km de distance).